Bloc 3 | Étude de cas | Afrique de l’OuestVulnérabilité partagée : L’augmentation du niveau de la mer et les zones côtières
Toutes les côtes du monde sont vulnérables aux impacts des changements climatiques et de l'augmentation du niveau de la mer. Le degré de vulnérabilité dépend de conditions géographiques et morphologiques locales, d'aspects sociaux-économiques, et du type de développement côtier. Le capital humain, social, économique, scientifique ou technique dont disposent les populations pour faire face aux modifications déterminent leur capacité de s'adapter à court, moyen et long terme. Comme démontre une brève comparaison des trois territoires étudiés – le Nouveau-Brunswick au Canada, le Delta du Saloum au Sénégal et la côte du sud du Bénin, la vulnérabilité, les stratégies d'adaptation et les freins à une adaptation efficace et durable montrent beaucoup de similitudes, malgré la constitution très différentes des trois territoires. Ainsi, les échanges de connaissances entre les communautés de ces territoires peuvent profiter à tous pour apprendre à mieux vivre avec les conséquences des changements climatiques.
1. Impacts
Partout dans le monde, les zones côtières sont aux prises avec des problèmes grandissants d’érosion et de submersion. Bien que ces phénomènes aient toujours existé et qu’ils fassent partie de la dynamique naturelle des côtes, l’influence des changements climatiques est clairement perceptible à travers l’augmentation de la fréquence des tempêtes majeures et des taux d’érosion sur la majeure partie des côtes.
Les conséquences se ressemblent à travers le monde. L’érosion des plages et l’endommagement des bâtiments figurent parmi les impacts majeurs (Figures 1 à 6). L’endommagement des voies de transport et des infrastructures routières, nécessitant leur réparation ou parfois même leur abandon représentent une des conséquences les plus coûteuses des inondations et de l’érosion côtière.

Source : S. Weissenberger, 2011

Source : M. Noblet, 2012
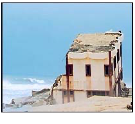
Source : PANA Bénin, 2008

Source : S. Weissenberger, 2012

Source : S. Weissenberger, 2013

Source : P. Jordan/MENB, n.d.
2. Adaptation
Les stratégies d’adaptation adoptées par les communautés dans les trois régions à l’étude présentent des similarités à plusieurs égards. Le premier réflexe d’adaptation est généralement la protection, à l’aide d’enrochements ou de murs (Figures 7 à 9). Le retrait est cependant également une réalité, autant au Bénin que dans le Delta du Saloum, où des villages ou parties de village ont dû être déplacés plus en hauteur ou plus loin de la côte. Au Canada aussi, le retrait commence à s’imposer comme une solution douloureuse mais incontournable dans des endroits comme Sainte-Flavie ou Le Goulet. Les limites des mesures de protection apparaissent dans tous les terrains d’étude : murs incomplets ou trop bas ne permettant pas d’éviter l’érosion, structures fragiles lors d’évènements météorologiques extrêmes, effet de bout et accélération de l’érosion des plages. Le renforcement des protections naturelles, qu’il s’agisse de végétalisation de dunes ou de plantation de mangroves, joue également un rôle dans les trois territoires étudiés.

Source : S. Weissenberger, 2011

Source : M. Noblet, 2012

Source : É. Lacoste-Bédard, 2014
L’influence humaine et l’aménagement de la côte peuvent avoir des effets délétères qui accentuent les problèmes d’érosion et d’inondations. Parfois, comme dans le cas de Saint-Louis au Sénégal, des interventions humaines vouées à résoudre un problème d’inondation, aggravent au contraire la situation ou sont même à l’origine de problématiques côtières.
Consultez à présent la vidéo dans laquelle Docteur Alioune Kane, de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), nous explique le cas de la brèche sur la Langue de Barbarie, à St-Louis, au Sénégal. Cet ouvrage humain qui avait pour objectif de faciliter la sortie de l’eau lors des inondations à St-Louis a eu pour effet imprévu d’accélérer l’érosion et de modifier les caractéristiques de la côte à un tel point qu’il a engendré le déplacement de populations.
Verbatim
Verbatim
Orateur 1
Comme vous voulez. Je pense qu'on va répondre aux questions que vous avez posées.
Orateur 2
Peut-être nous expliquer un peu la dynamique géophysique qui se passe à Saint-Louis, le croisement des marées, eau salée, eau douce ou ce qui vous paraît le plus inquiétant dans la région.
Orateur 1
Oui, le cas spécifique de Saint-Louis pour lutter contre les... parce que Saint-Louis, c'est une configuration un peu particulière. C'est un littoral qui est en équilibre entre une dynamique marine et une dynamique fluviale, avec une ville de moins de 200 000 habitants. Et donc, pour lutter contre les inondations, en tout cas, la solution préconisée a été d'ouvrir une brèche sur quatre mètres pour évacuer les eaux fluviales qui menaçaient un peu la ville alors que le problème a été connu. Mais ce canal opéré sur la Langue De Barbarie n'a cessé de s'élargir. Donc, nous, nous avons mis un observatoire des côtes un peu pour suivre l'évolution de ce canal de délestage. Mais ce canal n'a cessé de s'élargir et récemment, ce canal a une ouverture de plus de 6,5 km et la pénétration de l'eau de mer est devenue extrêmement forte. Et, avec ce canal, on a vu qu'il y a une accélération de la dynamique. Le milieu littoral a subi des transformations avec des évolutions de la trêve de côte. Sur la Langue De Barbarie, c'est tout ce qui était élément de protection qui a disparu, notamment le reboisement qui était en place. Et l'on a une plus forte pénétration de l'eau marine dans ce qu'on appelle le bas estuaire du fleuve Sénégal. Et, donc, mettons en cause un peu, menaçant un peu le pont Fédère et même le barrage de Diama qui est situé à quelque 35 km de la ville de Saint-Louis, a pu adapter un nouveau mode de gestion, en tout cas parce que les vannes du barrage ne sont pas faites pour supporter des niveaux amont, aval très fort, des différences de niveau très fort. Mais ce qu'on a surtout vu, c'est pour ces communautés côtières, on a assisté à la disparition d'établissements humains comme l'île de Boumbabake. Aujourd'hui, plus personne ne vit et pourtant, cette île a été antérieurement habitée avant même la ville de Saint-Louis. Et aujourd'hui, beaucoup de menaces existent sur la rive gauche du fleuve Sénégal, des établissements comme Paillote, Gagneolme, comme Bernard, etc., tous ces établissements-là aujourd'hui sont menacés, parce que la Langue De Barbarie qui constituait une barrière de protection aujourd'hui ne cesse de reculer, même si l'on assiste à une petite reconstitution dans la partie septentrion. Et ça, c'est un phénomène que nous essayons de voir. On ne peut pas dire que c'est le changement climatique qui est là, mais en tout cas, c'est l'aménagement de manière générale qui a créé ce genre de problème. Donc, c'est un cordon littoral extrêmement fragile, vulnérable. Et ce que nous voyons en plus, c'est que l'État n'a pas... On voit que sur ces milieux vulnérables, fragiles, l'État doit apporter des solutions, en tout cas, pour reconstituer ces milieux-là. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences de la création de ce canal de délestage ? C'est toute une dynamique qui a changé. C'est des répercussions sur l'agriculture, sur les nappes d'eau qui sont aujourd'hui salées, sur la vie des populations qui sont obligées de s'adapter autrement ou carrément d'aller vers l'immigration. Donc, énormément de problèmes qui sont créés, qui font que l'existence économique même de cette zone du Gagneolme se pose. L'état n'a pas encore apporté de solution. Nous savons le niveau faible et le niveau économique en tout cas faible de ces populations pour amener les moyens ou pour avoir les moyens nécessaires pour solutionner le problème. Donc, ce qui fait que vulnérabilité, fragilité de ces écosystèmes, mais également faible capacité de résilience de ces populations à trouver une solution à ces questions-là. Et donc, nous, nous réfléchissons un peu sur ces questions pour savoir quelles sont les solutions adéquates, des solutions ont été testées ou ont été proposées. Mais jusqu'à présent, en tout cas, il y a une dégradation extrêmement rapide de l'environnement et des ressources naturelles et des populations qui sont de plus en plus dans le désarroi. Et donc la recherche, comme on dit, ça fait dix ans que ce problème existe. La recherche devrait quand même pouvoir proposer des solutions et nous y réfléchissons.
3. Vulnérabilité
3.1 Composantes de la vulnérabilité
La vulnérabilité se décline souvent comme le produit de l’exposition, de la sensibilité et de la capacité d’adaptation. De manière générale, les trois territoires étudiés se montrent fortement vulnérables aux impacts des changements climatiques et aux risques côtiers; cette vulnérabilité ne s’articule cependant pas de la même façon dans les trois pays, ni même nécessairement au sein des pays. L’exposition des trois territoires est grande à cause de leur morphologie. Le littoral Acadien au Nouveau-Brunswick est de relief très faible favorisant les inondations et composé en grande partie de côtes sablonneuses ou de conglomérat glaciaires très propices à l’érosion. Le delta du Saloum est situé à très faible élévation et n’est protégé de la houle que par des cordons ou flèches littorales fragiles. La côte du Bénin se situe essentiellement au sein d’une plaine sablonneuse du quaternaire, entrecoupée de lagunes et d’embouchures de fleuves, dont l’élévation dépasse rarement dix mètres.
La sensibilité des territoires est fonction de la nature de leurs écosystèmes d’un côté et de l’occupation du territoire et de la dépendance aux ressources naturelles de l’économie locale. Sur ce point, les communautés d’Afrique de l’Ouest sont plus vulnérables puisque la pêche y occupe une place prépondérante dans l’emploi et la génération de revenus. L’agriculture, également fortement affectée par les impacts des changements climatiques et surtout par la salinisation des sols, contribue fortement à l'insécurité alimentaire. Sur le littoral acadien, le secteur tertiaire occupe une place plus grande dans l’économie régionale, or ce secteur est moins affecté par la variabilité et les changements climatiques. La problématique de la surpêche et de l’impact potentiel des changements climatiques sur les stocks d’espèces pêchées, capturées ou élevées s’y pose cependant également.
3.2 Adaptation, capacité, freins et apprentissage mutuel
La capacité d’adaptation est plus difficile à évaluer et à comparer, puisqu’elle est fonction de nombreuses variables d’ordre politique, économique, social, scientifique, éducative entre autres. La plus grande disponibilité de moyens financiers et matériels qu’on suppose dans un pays développé comme le Canada par rapport à des pays en développement comme le Bénin ou le Sénégal n’est pas un gage d’une plus grande capacité d’adaptation. La cohésion sociale, l’éducation, le réseautage, la sensibilisation de la population sont des facteurs tout aussi importants. La disponibilité de données scientifiques, comme des relevés lidar et des modèles d’élévation numériques produits sur la majorité du littoral Acadien, est un atout pour la planification des communautés, mais n’est profitable que si elle s’inscrit dans un processus d’adaptation soutenu par les acteurs. Ces outils s’avèrent peu utiles dans un contexte de faible gouvernance et contrôle sur le territoire, comme le montre le cas de la Plaine du Cul de Sac en bordure de Port-au-Prince en Haïti, où, malgré la disponibilité de ces outils, les plans de développement urbain ne tiennent pas compte des zones inondables (voir étude de cas Haïti)
Fait intéressant, les enquêtes menées sur les trois terrains identifient les mêmes freins à l’adaptation. On observe ainsi des thèmes récurrents :
- Développement dans des zones à risque
- Augmentation de la valeur et de l’attrait du domaine littoral
- Manque de soutien des autorités
- Absence d’une vision à long terme
- Déficit d’information scientifique
- Adaptation réactive avec des moyens improvisés
- Adaptation axée fortement sur la protection – souvent irréaliste
- Vulnérabilité des femmes
Ainsi, bien que moins vulnérables sur certains plans, les communautés des pays développés ne sont souvent pas mieux préparées à affronter les risques côtiers. Cette observation, qui a déjà été faite lors d’une comparaison Sénégal-Nouveau-Brunswick (Noblet, 2015), ou à l’exemple du Bangladesh, universellement reconnu pour ses efforts d’adaptation, ouvre la possibilité d’apprentissages mutuels plutôt que de transfert de connaissances unidirectionnels des pays développés vers des pays en développement. D’ailleurs, des communautés canadiennes s’inspirent d’adaptation de communautés de pays en développement autant que développés (Figure 10).
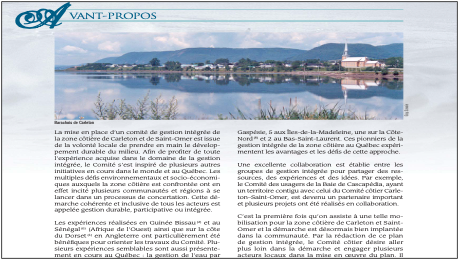
Source : Municipalité de Carleton